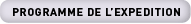Entretien avec Jean Marc Drouin, philosophe et historien des sciences
Entretien avec Jean Marc Drouin,
philosophe et historien des sciences
au Muséum National d’Histoire Naturelle - Paris
Propos recueillis par Michelle Folco et Sophie Mouge, professeurs relais pour l’académie de Créteil au Muséum (Direction de la Recherche, de l’Enseignement et de la Pédagogie - Muséum National d’Histoire Naturelle)
Avec l'aimable collaboration de Gilles Camus (webmaster du site "Vie") pour la partie vidéo.
Mr Drouin, en tant que philosophe et historien des sciences, comment définiriez-vous le terme ‘biodiversité’ ?
La biodiversité est la diversité biologique qui peut se définir à trois niveaux : diversité génétique (à l’intérieur de l’espèce), diversité des espèces et diversité des écosystèmes. La notion est apparue dans les années 80 avec l’expression de ‘diversité biologique’ et la définition de ses trois niveaux. Par la suite, le mot ‘biodiversité’ a contribué au succès de son concept mais d’une certaine façon, l’idée était présente depuis longtemps. Les disciplines naturalistes révolutionnées par l’évolution et l’écologie sont des savoirs basés sur la diversité naturelle, c’est-à-dire biologique (et géologique). Se pose alors le problème des rapports entre la diversité naturelle et la diversité culturelle du lieu.
Donc finalement, le concept de diversité du vivant va subir une évolution au fil des découvertes scientifiques. Le concept était donc déjà né avant qu’on lui attribue un terme précis : biodiversité ?
Un concept existe-il avant qu’il soit nommé ? C’est un grand problème récurrent dans les discussions entre les philosophes-historiens des sciences !
On l’admet bien pour l’évolution puisque Lamarck lui-même n’employait pas encore le terme ‘évolution’ ni même ‘transformisme’.
Statue de Lamarck dans le Jardin des Plantes à Paris
Il disait clairement que les espèces se transforment, l’expliquait et donnait même un mécanisme (qui n’est pas celui qu’on retiendra par la suite) mais aucun mot concret ne résumait ces processus malgré l’existence de périphrases. Pour la diversité des espèces, cela paraît plus difficile. Mais il me semble tout de même qu’on peut parler de biodiversité des espèces avant la naissance du concept.
Un botaniste de la fin du XVIIIème siècle (ou du début du XIXe siècle) remarquait qu’on accusait les botanistes d’utiliser une profusion de termes. Ceux-ci répondaient que c’était comme si on accusait la nature d’être trop prodigue ! Il y a l’idée d’une profusion d’espèces qui entraîne une profusion de noms... Alors que certaines sciences tendent à simplifier et à ramener la diversité du réel sous un principe unique, c’est le contraire qui s’opère en biologie : il faut rendre compte de la diversité.
Les grandes théories du XIXème siècle seront donc amenées à la fois à souligner l’unité du vivant et en même temps sa diversité.
L’idée de biodiversité était donc déjà présente, comment pouvait-on l’estimer ?
Il existait différents calculs : on essayait d’estimer le nombre moyen d’espèces par genre. Par la suite on tentait d’évaluer les rapports entre la surface d’un pays et le nombre d’espèces qui s’y trouvaient. Puis au début du XIXème siècle, l’émergence de l’arithmétique botanique a permis des comparaisons du nombre d’espèces selon les différents groupes systématiques.
À l’époque de la Révolution française, on cherchait à justifier l’utilité de l’histoire naturelle. Constatant qu’une forêt ne possédait que 25 espèces d’arbres différentes, il paraissait crucial d’en importer pour en avoir plus et donc davantage de diversité : c’est l’époque de l’émergence des jardins d’acclimatation. On justifie l’utilité sociale de la connaissance naturaliste par l’augmentation du nombre d’espèces par importation d’espèces étrangères dans un pays. Quantité d’introductions ont été bénéfiques ou neutres. Mais actuellement la tendance est plutôt à la peur car certaines introductions ont eu des influences nocives (notamment dans les îles et les milieux fermés).
Si l’on reprend une analyse critique de Raphael Larrère lors d’un récent colloque, on peut se demander s’il existe une bonne et une mauvaise diversité. Par exemple, si l’importation de quantités de plantes dans une île des Kerguelen fait disparaître les plantes endémiques, il n’y a aucun gain. Mais il ne faut pas considérer non plus que toute migration d’espèces soit à proscrire. Il s’agit d’un thème important qui touche à l’éthique de l’environnement, à des problèmes de valeurs et qui demandent beaucoup de connaissances théoriques de la part des collègues de disciplines telle que l’écologie.
Comment percevez-vous le travail actuel fait sur l’île de Santo ?
Ce qui me semble intéressant dans la mission Santo, c’est la permanence de la démarche de « voyage ». Fontenelle, un philosophe du XVIIIème siècle, faisant l’éloge de Tournefort disait que la botanique n’est pas une science sédentaire parce que les livres pour s’en instruire ont été dispersés à la surface de la Terre ; si on veut étudier la faune, la flore et la géologie des îles du Pacifique, il faut que des gens aillent sur place et plus précisément des scientifiques.
Dans ce sens, la mission actuelle sur l’île de Santo est d’un grand intérêt.
D’abord il est réjouissant de voir la permanence du voyage comme démarche scientifique. De même que dans l’histoire de la médecine, on constate la permanence de la clinique, c’est-à-dire de l’observation du cas. La médecine se transforme, se modernise l’observation du cas demeure. Les mathématiciens d’aujourd’hui ne sont plus ceux du temps d’Archimède mais continuent cependant de calculer. L’expérimentation a joué un rôle décisif dès l’époque de Galilée en physique, de Lavoisier en Chimie ou de Claude Bernard en physiologie, elle est de nos jours différente mais reste une démarche fondamentale.
Il y a des démarches comme celle du questionnement du réel qui imposent un déplacement - qu’il s’agisse d’un déplacement de proximité ou d’une grande expédition scientifique. Dans certains cas, la grande expédition est le seul moyen efficace de répondre aux questionnements des chercheurs. Elle permet à la fois d’aller chercher un objet qu’on ne trouve pas sur place et de voir varier les conditions de milieu. Epistémologiquement, il s’agit d’une démarche fondamentale.
Il est donc vraiment important que des expéditions puissent encore voir le jour et qu’elles se fassent en relation avec le public. En effet ces grandes expéditions ont contribué à l’évolution théorique des disciplines naturalistes et ont de surcroît alimenté l’imaginaire et l’intérêt du public pour les questions scientifiques.
À quelle période peut-on commencer à dater les premiers inventaires de faune et de flore effectués par les scientifiques ?
Les premiers inventaires datent de la fin du XVIIème siècle, mais surtout du XVIIIème siècle, le siècle des Lumières. À l’époque, on parlait de catalogues et non d’inventaires car il y a dans ce mot une notion de fragilité et d’appartenance à un patrimoine ; c'est-à-dire que le mot inventaire suggère une peur de la disparition, ce qui n’était pas le sentiment unanime à l’époque des premiers voyages naturalistes.
Pourquoi les scientifiques ont alors ressenti le besoin de faire des catalogues de la biodiversité ?
Ce besoin d’élaborer des catalogues répond tout d’abord à des motivations économiques.
D’une certaine façon, ce sont les Européens qui font le catalogue de la diversité biologique des autres parties du monde donc de ce point de vue-là, on ne peut pas ne pas parler de différentes aires culturelles. Sur place, ils rencontrent des savoirs locaux concernant cette diversité. Selon les cas, les pays et les individus, soit ils prennent en compte ces savoirs et il y a rencontre et métissage culturels, soit ils arrivent en pays conquis et alors il y a un vide. En fait, tout n’était pas forcément déjà connu et il arrivait aussi aux scientifiques de découvrir des plantes ou des animaux auxquels les gens sur place n’avaient pas forcément pris garde.
Un paradoxe est souvent soulevé par les auteurs du XVIIIème siècle. En effet, les plantes et animaux rencontrés sont déjà intégrés aux cultures sur place. Or, en l’honneur d’Adanson, on a donné au baobab le nom d’Adansonia, mais lui-même protestait en arguant qu’il s’agit d’un arbre africain et qu’il faut donc l’appeler baobab et non du nom de son descripteur européen!
Adansonia
Un des autres buts de ces catalogues était aussi de répertorier les ressources dont on dispose, c'est-à-dire la diversité qui est utile pour l’homme. Avant même les premiers naturalistes en voyage en Amérique, les marins avaient déjà rapporté le tabac, la pomme de terre, la tomate, le maïs etc…
Le cadre de vie quotidien, les jardins et la nourriture sont profondément marqués par le transfert des plantes et animaux d’un continent à l’autre. C’est l’époque où on rêve d’acclimater quantités d’arbres dans nos forêts.
Certaines espèces étaient aussi rapportées à la cour : ont-elles contribuées à l’élaboration des cabinets de curiosités ?
Les espèces étaient effectivement rapportées à la cour, mais mortes et constituaient les cabinets de curiosité. Par la suite, toutes les espèces vivantes collectées ont permis d’élaborer des cabinets d’histoire naturelle.
On peut dire d’une certaine façon qu’à la Renaissance et au début du XVIIème, on cherche l’élément curieux comme par exemple le rémora, la rose de Jéricho, le bezoar, la dent de Narval. Ensuite, les scientifiques se sont dits que toutes les coquilles d’escargot des jardins, tous les chênes d’Amérique du nord pourraient être aussi intéressants à étudier. On passe donc de l’extraordinaire, du curieux et du merveilleux à une forme de recherche d’exhaustivité.
Cette recherche est liée à des intérêts économiques, à la recherche de médicaments, mais aussi à une idée de la richesse de la nature. Pour Galilée et les autres géomètres, la nature est écrite en langage mathématique, mais pour les naturalistes, c’est un trésor. Les idées religieuses étaient omniprésentes et soulignaient une profusion de la nature. Le premier jardin botanique était pour eux celui d’Eden ! Finalement, la connaissance de la biodiversité était à l’époque une façon de se rapprocher le plus possible de Dieu et des créatures qu’il aurait créées…
Ceci me rappelle une plaisanterie à propos du généticien Haldane : un théologien lui avait demandé si l’histoire naturelle nous apprenait quelque chose sur Dieu et ce dernier lui a répondu : ‘Oui ! Un amour immodéré des coléoptères !’…
Comment procédaient ces scientifiques pour faire le catalogue de toute cette faune et flore, sachant que les techniques de l’époque n’étaient pas aussi sophistiquées que celles d’aujourd’hui ?
Il existe un livre d’Yves-Marie Alain sur le voyage des plantes à l’époque de la marine à voile. On note que le transport des plantes vivantes présente un aspect héroïque et lourd de conséquence. Actuellement, on ne s’étonne plus de trouver du café ‘pur Arabica Colombie’ alors que l’aire d’origine de ce café est dans la péninsule arabique ! Ces plants ont été transportés par les Hollandais dans leurs colonies d’Asie du sud-est, donnés ensuite au Jardin des plantes de Paris puis transportés dans les Antilles. L’histoire raconte que le premier voyageur qui a apporté un pied de café aux Antilles a partagé sa ration d’eau avec son plant de café à cause d’une pénurie à bord ! De même, Bernard de Jussieu aurait rapporté d’Angleterre, un cèdre du Liban dans son chapeau ! Cet arbre se trouve actuellement au Jardin des plantes.
Cédre du Liban, exposé dans le jardin des plantes
L’important est de constater qu’il s’agit d’une tâche difficile, qui est réalisée aux XVIIIème et XIXème siècles. De ces expéditions, il nous reste des caisses dont l’une est actuellement exposée dans la grande galerie de l’évolution du Muséum de Paris -sorte de petites serres de voyage faites en grillage et verre pour le transport de plantes vivantes. Le transport des graines était lui plus facile.
Ne s’agissait-il donc que de scientifiques qui partaient par pure curiosité dans le but de découvrir de nouvelles espèces ?
Au début, de nombreux collecteurs non scientifiques rapportaient des spécimens aux scientifiques qui pour la plupart ne voyageaient guère. Mais au fil du temps, les scientifiques ont fait partie des expéditions : il n’est qu’à rappeler le jeune Darwin partant sur le Beagle pour faire le tour du monde ou encore Philibert Commerson qui part dans l’expédition dirigée par M. Bougainville et trouve un arbuste au Brésil auquel il donne le nom du chef de l’expédition, le Bougainvillier : arbuste des zones chaudes tempérées et tropicales actuellement connu de tous !
Un bougainvillier du jardin du Val Rahmeh à Menton
Les scientifiques arrivaient-ils à quantifier le nombre d’espèces qu’ils inventoriaient et avaient-ils conscience des manques ?
Ils disposaient d’un dénombrement des espèces : quelques milliers au XVIIème siècle, quelques dizaines de milliers au XVIIIème et enfin des centaines de milliers au XXème siècle. Chaque siècle, 10 fois plus d’espèces sont mises en évidence. On ne peut pas connaître toutes les espèces, ni les retenir, ni les classer. Ainsi Tournefort, afin de les regrouper, fixa la notion de ‘genre’, puis d’autres naturalistes ont défini celle de famille etc. D’une certaine façon, le travail de classification et de nomenclature est lié aux nécessités de traiter cette multitude de plantes ou d’animaux.
Concernant les manques, les scientifiques ont le sentiment que le travail de classification est indispensable d’un point de vue pratique, car pour ranger il faut classer. Cela les aide à refléter l’ordre de la nature pour donner un sens à la classification. Se pose alors le problème des transitions entre familles et la question de savoir comment boucher les « trous » entre groupes systématiques.. Tous pensent alors qu’une classification naturelle est un idéal à atteindre mais beaucoup estiment qu’on y parviendra seulement lorsque davantage de plantes seront répertoriées.
Imaginons que l’exploration d’une île amène la découverte de 300 espèces. Représentent-elles le tiers, la moitié ou les 3/4 de ce qui existait réellement ? Ceci restait difficile à dire. Mais des estimations ont vu le jour au fil du temps, liées à la naissance de la biogéographie. Après la phase de quête de curiosités, puis de catalogues exhaustifs s’impose l’idée d’une distribution des espèces dans l’espace. Par exemple, certaines espèces animales ou végétales se trouvent un peu partout et d’autres sont endémiques (on ne les trouve que là).
Une idée émerge bientôt : dans les îles, il y a proportionnellement moins d’espèces que sur une surface égale de continent (à paramètres égaux).
Vous semble-t-il avisé de parler aujourd’hui de crise de la biodiversité ?
On peut parler de crise mais à condition de savoir qu’il ne s’agit pas de la première et qu’elle n’est pas unique. Il ne s’agit pas de ‘la Crise’ mais plutôt de plusieurs situations de crises. Il existe des diversités d’usage et de pratiques culturelles qui créent des diversités naturelles.
Un des intérêts d’une expédition comme SANTO 2006 est justement de prendre la mesure du changement. Ce changement a des caractères de crise mais aussi des caractères de transformations et de rencontres même si on a l’impression que les aspects catastrophiques dominent.
Actuellement, on ne connaît que 1,5 million d’espèces alors qu’il en existerait 15 millions. Pensez-vous que la notion de crise garde alors toute sa dimension ?
Je ne connais pas ces chiffres et je laisse aux collègues scientifiques le soin de les préciser.
Ce que l’on ne connaît pas disparaît sans doute aussi vite que ce que l’on connaît, donc il y a certainement des espèces qui disparaissent avant même qu’on ne les connaisse.
Par exemple, l’homme a eu le temps de connaître le Dodo avant sa disparition. Cela paraît rassurant car l’idée que des espèces vont disparaître sans même les avoir connues est frustrante. En effet, on ne peut alors pas en conserver de traces matérielles : certains produits de l’évolution sont perdus, ce qui prive le monde vivant de possibilités de changement. On se prive des possibilités d’évolution de nouvelles ressources, d’adaptation à des changements climatiques ou autres.
Je crois qu’il ne faut pas opposer l’idée de transformations continuelles dans la nature au souci de protéger, de conserver et de préserver les ressources naturelles, même si tous ces termes ne sont pas équivalents. De même il ne faut pas opposer diversité culturelle et diversité naturelle parce que la diversité des cultures vient aussi de la diversité des environnements naturels. Parallèlement, la diversité des cultures, par la diversité des usages qu’elle induit, contribue à la diversité naturelle. Il y a donc un cercle vertueux, un enrichissement mutuel et une interaction. Même si toutes les idées de développement durable présentent beaucoup d’ambiguïtés et ne sont pas toujours très claires, on relève quand même cette idée de préserver des possibilités de changements et en quelque sorte de ne pas brûler nos vaisseaux.
En voulant préserver cette biodiversité, n’y a-t-il pas un risque que l’homme canalise l’évolution des êtres vivants et finisse par la freiner ?
Non, l’homme ne va pas canaliser l’évolution en voulant préserver la biodiversité. Il me semble plutôt qu’il y a danger si on ne lutte pas pour préserver la biodiversité car on canalise alors l’évolution en réduisant ses possibilités. Si on ne fait rien et qu’on laisse simplement faire l’effet des forces économiques, des transformations non voulues de la nature, alors il y a danger.
Le problème que vous soulevez existe, mais il me semble qu’il y a moins de dangers si on agit sur la préservation de la biodiversité que si on ne lutte pas et qu’on laisse polluer toutes les rivières par exemple ou si on laisse faire l’effet de serre au maximum… Car dans ce cas, on va se retrouver entraîné dans un flux de changements complètement canalisés qui ne sont pas obligatoirement ceux qui sont les plus souhaitables.
L’action de l’homme sur la nature a d’un autre côté des aspects positifs. C’est par ses pratiques par exemple que l’on peut nourrir autant d’hommes sur terre, qu’on a pu réguler des maladies… Il ne faut pas avoir un point de vue purement négatif, l’important c’est surtout de faire un état des lieux et être conscient du fait qu’il faut maîtriser notre propre pouvoir sur la nature. Ceci est difficile car longtemps l’homme a été faible devant la nature donc il a pris l’habitude de lutter contre elle et non de la préserver.
Actuellement, encore, des éléments naturels nous rappellent que nous ne sommes pas toujours les plus forts…
Mais pensez-vous qu’il soit quand même souhaitable de conserver la biodiversité en l’état ?
Non, il faut ne faut pas obligatoirement conserver la biodiversité en l’état, mais il faut conserver les possibilités de changement. On peut faire le rapprochement avec l’idée de patrimoine : si on veut transmettre quelque chose aux générations futures, il ne faut ni ne toucher à rien ni « vendre la maison ». Il faut laisser évoluer les choses…
En fait, le problème de la crise de la biodiversité pose le problème du rythme de l’évolution. Ce rythme est devenu si important que l’extinction qui nous menace risque d’être irréversible. Si on ne maîtrise pas mieux notre ascendance sur la nature, alors vont disparaître des capacités de récupération de la nature et d’adaptation aux changements.
En fait, la crise de la biodiversité touche directement l’Homme : la prise de conscience de son existence le concerne donc directement et pas seulement la Nature au sens large.
D’après-vous peut-on dater cette prise de conscience ?
Cette question est un vrai socle de discussion : je crois que tout le monde devrait pouvoir admettre que l’avenir de l’espèce humaine, au moins d’un point de vue qualitatif, réclame un certain nombre de changements dans nos attitudes vis-à-vis de la nature.
On trouve des naturalistes dès le XIXème siècle qui expliquent que lorsqu’une forêt disparaît - Auguste St Hilaire parle de déforestation au Brésil - plusieurs plantes utiles, comme des médicaments, sont peut-être en train de disparaître. Mais en envisageant les thèmes du changement global cela prend encore une autre échelle. Ce n’est pas simplement une espèce qui aurait pu être à l’origine de ressources importantes qui disparaît, mais c’est aussi notre propre environnement de vie.
La grande question qui est posée à la philosophie de l’environnement par certains auteurs est : est-ce que cette prise de conscience est suffisante ? Protéger la nature pour nous protéger c’est encore de l’anthropocentrisme, un anthropocentrisme subtil, mais un anthropocentrisme tout de même. C’est une sorte d’égoïsme intelligent. Ne faudrait-il pas aller plus loin jusqu’à reconnaître aussi une certaine forme de valeur intrinsèque aux choses de la nature ?
De la même manière que l’on pense que si la Joconde, Notre Dame de Paris ou la Tour Eiffel disparaissaient cela représenterait une perte importante, de la même manière savoir que tel paysage du grand nord canadien ou telle espèce de la canopée tropicale existe, cela a une valeur.
En effet il faut les considérer comme des produits de l’évolution, les produits d’une histoire et dire qu’ils ont une valeur. Il ne s’agit pas de dire que leur valeur doit l’emporter sur tout autre considération et que c’est la seule valeur mais je crois qu’il faut aller un peu plus loin que l’argument d’utilité. En tout cas, défendre la nature et ses produits, d’une certaine manière, c’est aussi vouloir défendre l’Homme.
Le darwinisme et toute l’histoire naturelle nous ont appris que nous appartenons à cette nature et que nous sommes donc embarqués dans la même aventure qu’elle. C’est déjà une première prise de conscience et nous pouvons aller au-delà en donnant une certaine forme de valeur à des éléments de la nature. Ceci dit, s’il fallait choisir entre le virus du SIDA et les êtres humains, il n’y aurait pas à hésiter ! Mais c’est souvent très compliqué car entre les tigres et les paysans de l’Inde qui se font attaquer par les tigres, par exemple, la cohabitation est très difficile.
Ainsi il est parfois très difficile de concrètement arbitrer. Mais après tout, la politique, la morale et la philosophie sont pleines d’arbitrages entre des valeurs contradictoires.
Peut-on parler de « valeur » en opposition avec « utilitaire » ? Est-ce qu’historiquement on a des exemples qui montrent que les arguments utilitaires ont finalement plus de moyens de faire avancer les choses que les arguments de valeur ?
Dans l’histoire on retrouve les deux, mais disons que les jugements de valeur ne deviennent opérants que lorsqu’ils ont des financements. En même temps, trouver des financements pour faire quoi ? Il faut bien avoir des jugements de valeur, d’abord pour convaincre le public de l’intérêt de la chose et puis pour que cela ait un sens.
On ne va pas dire que l’on envoie une expédition avec 150 scientifiques et que l’on donne des moyens financiers simplement pour donner bonne conscience à des groupes industriels. On va dire que :
- l’expédition a un intérêt scientifique parce que cela fait partie de la gloire de l’esprit humain de chercher à connaître le réel
- que pour protéger les éléments de la nature, il faut les connaître
- que cette nature est aussi le cadre de vie de culture et de populations locales avec lesquelles on peut essayer d’établir d’autres liens que ceux qui existaient à l’époque coloniale. Ce sont là des arguments de valeur morale. Regardez ce qui se passe avec l’art, les journées du patrimoine mobilisent un tas de gens. Finalement l’humanité marche aussi aux valeurs et pas seulement aux intérêts.
Mais après, une fois que l’on a déterminé par des valeurs qu’une expédition scientifique est importante pour trouver les moyens de la réaliser, il faut aussi un dédommagement en termes d’utilité.
Ainsi, je mettrais d’abord le jugement de valeur et après il faut être réaliste en cherchant des compensations, des dédommagements, des financements en termes d’utilité, mais l’utilité pour l’utilité ne mènerait à rien…
On distingue dans le public concerné par les missions, le grand public et le public scolaire. Quel message voudriez-vous faire passer aux enseignants qui se retrouvent face aux questions de leurs élèves sur la crise de la biodiversité ? Pensez-vous que les enseignants doivent alerter les élèves ? L’enseignant a-t-il un rôle à jouer ?
‘Alerter’ est un bien grand mot car il annonce une catastrophe. Non je verrais plutôt pour l’enseignant l’idée qu’il doit transmette des notions, qu’il doit éduquer les élèves à la liberté des citoyens.
La citoyenneté, la liberté, le rapport au savoir, la transmission des valeurs culturelles ça comprend entre autres choses la prise de conscience du rapport à la nature. Je crois que, d’une certaine façon, c’est ce que les enseignants ont toujours fait à l’école en transmettant la culture qui est un type de rapport à la nature.
L’enseignant a tellement de choses à enseigner que c’est plutôt à lui de voir dans ce qu’il enseigne ce qui s’inscrit dans la biodiversité plutôt que d’en rajouter.
Mais peut-être que par une ruse de la raison, cette nature lointaine et exotique qui a un parfum d’aventure peut aussi amener à voir la nature proche, la nature au quotidien. Il existe également une chose qui peut être réconfortante pour les enseignants, c’est de voir que les expéditions font évoluer l’image de la science. Les élèves ont parfois une image stéréotypée de la science : celle du savant fou, de la science toute puissante, de la science confondue avec la technologie. Alors que pour les élèves, étudier la carte de répartition d’une espèce de palmier ou la reconstitution d’un arbre généalogique des poissons, c’est aborder différemment la science. Il ne s’agit pas d’opposer une bonne science qui a un parfum d’aventure et qui est respectueuse de la nature a une science dure, mais il s’agit de montrer qu’il y a de multiples manières de faire de la science.
Le pluralisme épistémologique c’est-à-dire l’idée que toutes les démarches scientifiques ne sont pas sur le même modèle est illustré ici. Selon la diversité des objets que l’on étudie il y a une diversité d’approche. La science reste une aventure humaine !
Un des aspects intéressants de l’expédition SANTO sera d’observer sur les photographies la rencontre des scientifiques avec les populations autochtones. En effet il est important de montrer que l’expédition n’arrive pas sur une terre vierge. Il y a une rencontre avec la population locale et la science n’est pas faite que par l’Europe mais par la rencontre de l’Europe avec les autres aires culturelles.